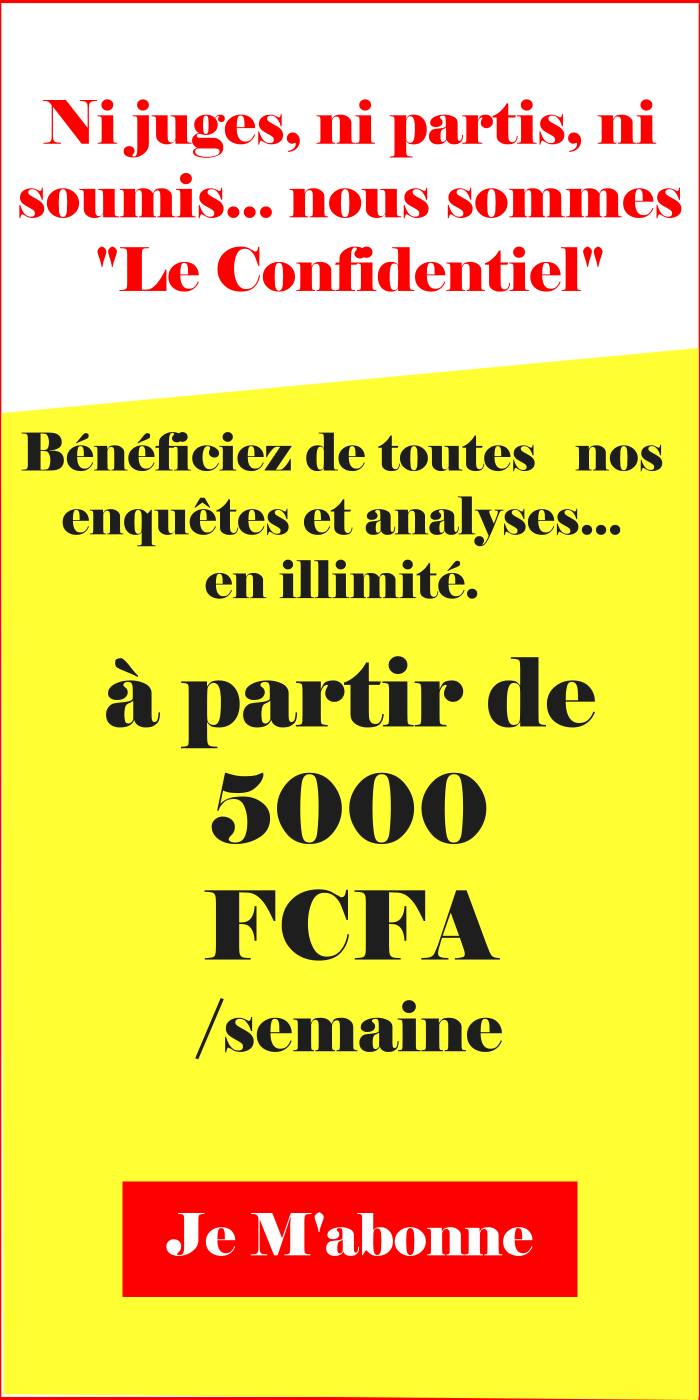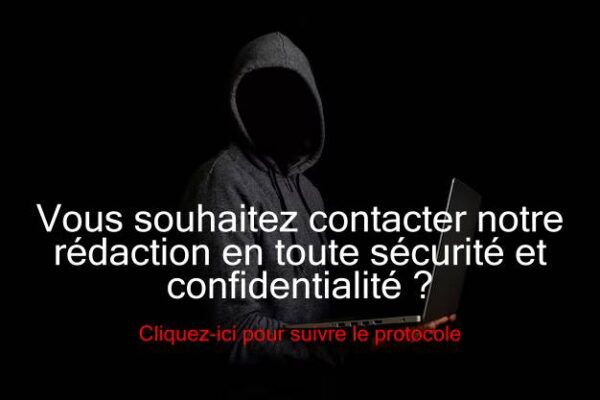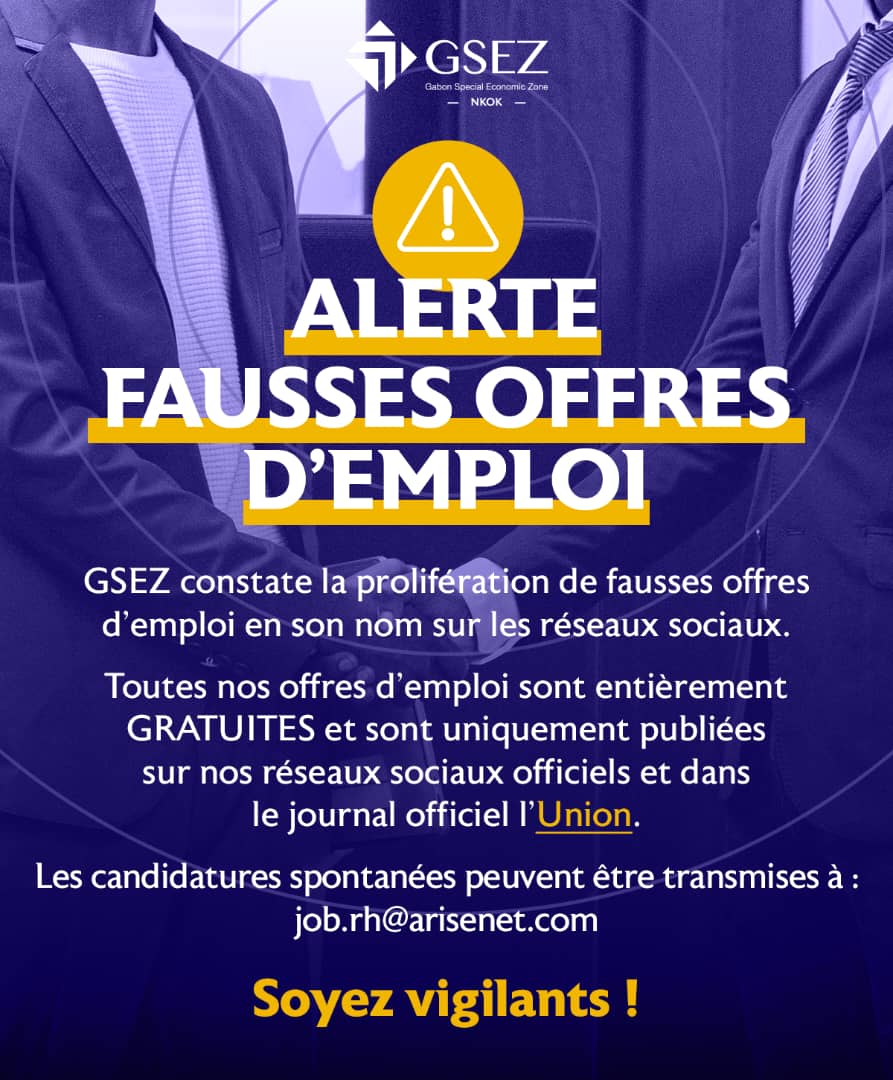Par Jérémie Ayong Nkodjie Obame, dirigeant d’entreprise, expert du secteur pétrolier et gazier
Cette tendance baissière s’inscrit dans un panorama global peu reluisant. Les perspectives économiques mondiales restent moroses, plombées en toile de fond par les tensions commerciales persistantes initiées par Washington. Au-delà de ces facteurs conjoncturels, des éléments structurels pèsent également sur les prix.
La simple perspective d’un accord sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran – bien que les pourparlers soient actuellement suspendus – suffit à faire frémir les marchés. Un tel accord pourrait signifier la levée des sanctions et le retour potentiel de près de 3,5 millions de barils iraniens par jour sur un marché déjà bien approvisionné, exerçant une pression déflationniste significative sur les cours.
Dans ce jeu complexe, l’Arabie saoudite, poids lourd de l’OPEP+, a opéré un changement de cap notable. Riyad a signalé ne plus vouloir endosser seule le rôle de stabilisateur des prix via de nouvelles coupes de production, marquant une rupture avec sa stratégie passée. Ce revirement laisse présager une probable augmentation de la production de l’alliance OPEP+ en juin, pour le deuxième mois consécutif. Les analystes y voient une véritable offensive pour regagner des parts de marché, motivée doublement : d’une part, la volonté de pénaliser les membres de l’alliance jugés peu respectueux des quotas (l’Irak et le Kazakhstan sont souvent cités) ; d’autre part, et crucialement, l’anticipation du retour iranien. Riyad n’entend visiblement pas faire de cadeau à Téhéran, son grand rival régional, en lui facilitant la reconquête du marché par une politique de raréfaction de l’offre saoudienne.
Pendant que les géants mondiaux s’affrontent sur l’échiquier pétrolier, le Gabon, lui, concentre son attention sur la valorisation locale de sa production. Fait notable, les discussions dans les cercles pétroliers nationaux se sont récemment focalisées non pas sur l’exploration-production (l’amont), mais sur le raffinage (l’aval).
Le management de la Société Gabonaise de Raffinage (Sogara) vient en effet de présenter un ambitieux programme d’expansion au Ministre du Pétrole, Marcel Abéké. L’objectif est clair et stratégique : atteindre l’autosuffisance du pays en produits pétroliers (carburants notamment) d’ici 2030. Pour y parvenir, un investissement conséquent de 40 milliards de Francs CFA est prévu.
Ce plan vise à tripler la capacité de raffinage actuelle de la Sogara, pour la faire passer de 900 000 tonnes par an à 2,772 millions de tonnes. Cela passera par la modernisation de l’usine existante de Port-Gentil et la construction d’une nouvelle unité sur un vaste site de 130 hectares en bordure de l’Ogooué-Maritime.
L’initiative est plus que bienvenue. Actuellement, l’unique raffinerie du pays ne traite qu’une faible part (moins de 10%) de la production nationale de brut, qui avoisine les 10,9 millions de tonnes par an. Conséquence directe : le Gabon a dû importer pour près de 655 milliards de Francs CFA de produits pétroliers en 2023 afin de couvrir sa demande intérieure.
Le projet de la Sogara apparaît donc économiquement et financièrement pertinent. En visant à raffiner localement la quasi-totalité des besoins domestiques, le Gabon réduirait drastiquement sa facture d’importation et sa dépendance extérieure. Cerise sur le gâteau, cette démarche s’inscrit parfaitement dans l’objectif de souveraineté économique et énergétique prôné par les autorités de la Transition. Face à la volatilité des marchés mondiaux, le Gabon fait le pari stratégique de la transformation locale.