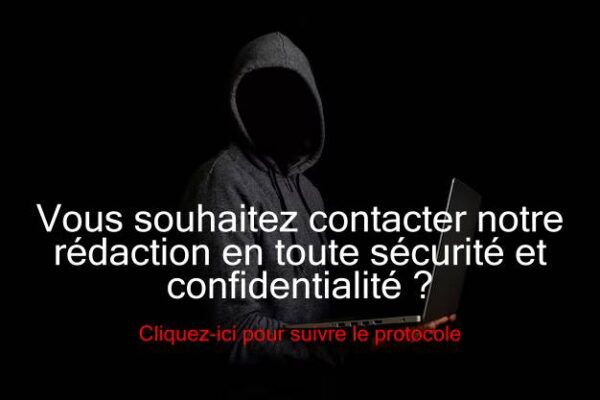Cette fragmentation trouve ses racines dans l’histoire des luttes sociales. Dans les années 90, le régime d’Omar Bongo Ondimba avait cru bon d’alléger les démarches pour la création d’un syndicat afin de limiter, à l’époque, l’influence du SENA en multipliant le nombre de syndicats à sa solde comme contre-pouvoir. En mettant en avant que cette diversité reflète la vitalité et le plurialisme le régime a favorisé cet émiettement. Pourtant, sur le terrain, cette atomisation crée un paradoxe. Alors que les revendications — rappels de solde, avancements, conditions de travail — sont quasi identiques d’une structure à l’autre, la multiplication des interlocuteurs complique singulièrement la tâche du ministère de la Fonction publique et de l’Éducation nationale.
Le risque majeur de ce paysage morcelé est celui de la surenchère. Pour exister médiatiquement et fidéliser ses adhérents, chaque organisation est parfois tentée de durcir le ton plus que sa voisine. Cette dynamique peut transformer le dialogue social en une course à l’échalote où le compromis devient synonyme de trahison. À l’inverse, le gouvernement peut être tenté de jouer sur ces divisions, appliquant le vieil adage « diviser pour mieux régner », en choisissant ses interlocuteurs selon les circonstances, au risque de laisser de côté les acteurs les plus représentatifs.
La question de la représentativité est d’ailleurs le point aveugle de cette multitude. En l’absence d’élections professionnelles régulières et transparentes permettant de peser réellement le poids de chaque syndicat, la légitimité se mesure souvent au bruit fait sur les réseaux sociaux ou à la capacité de paralysie du système éducatif. Cette situation laisse les enseignants et les parents d’élèves dans un flou permanent : qui parle réellement au nom de qui ?
Si la même mécanique avait été retenue, comme ce fut le cas pour les syndicats, sur le plan politique, en laissant créer une multitude de partis politiques pour affaiblir l’opposition, le pays serait ingouvernable. Le gouvernement a mis de l’ordre en durcissant le règlement relatif à la création de partis politiques et en exigeant plusieurs démarches rigoureuses ; il est aussi temps qu’il mette de l’ordre à ce niveau. Actuellement, le contraste est saisissant : alors que pour créer un parti politique les exigences sont multiples, pour créer un syndicat, il suffit de faire une simple déclaration à la mairie. Pour un syndicat, c’est la loi n°18/92 (Code du travail) qui s’applique, exigeant uniquement le dépôt des statuts à la mairie, avec une simple information au ministère du Travail et au parquet. Cette facilité administrative favorise l’émiettement du paysage social.
Enfin, cette dispersion des forces pose la question de la sortie de crise. Lorsqu’une plateforme comme la Conasysed voit ses leaders comme Marcel Libama ou Simon Ndong Edzo inquiétés par la justice, la réaction en ordre dispersé des autres syndicats souligne parfois un manque de solidarité organique. Pour que l’école gabonaise retrouve sa sérénité, une rationalisation du paysage syndical semble inévitable. Sans une forme d’unité d’action ou de regroupement, le mouvement syndical risque de s’épuiser dans une multitude de micro-conflits, laissant le système éducatif dans une instabilité chronique dont les élèves restent les premières victimes.