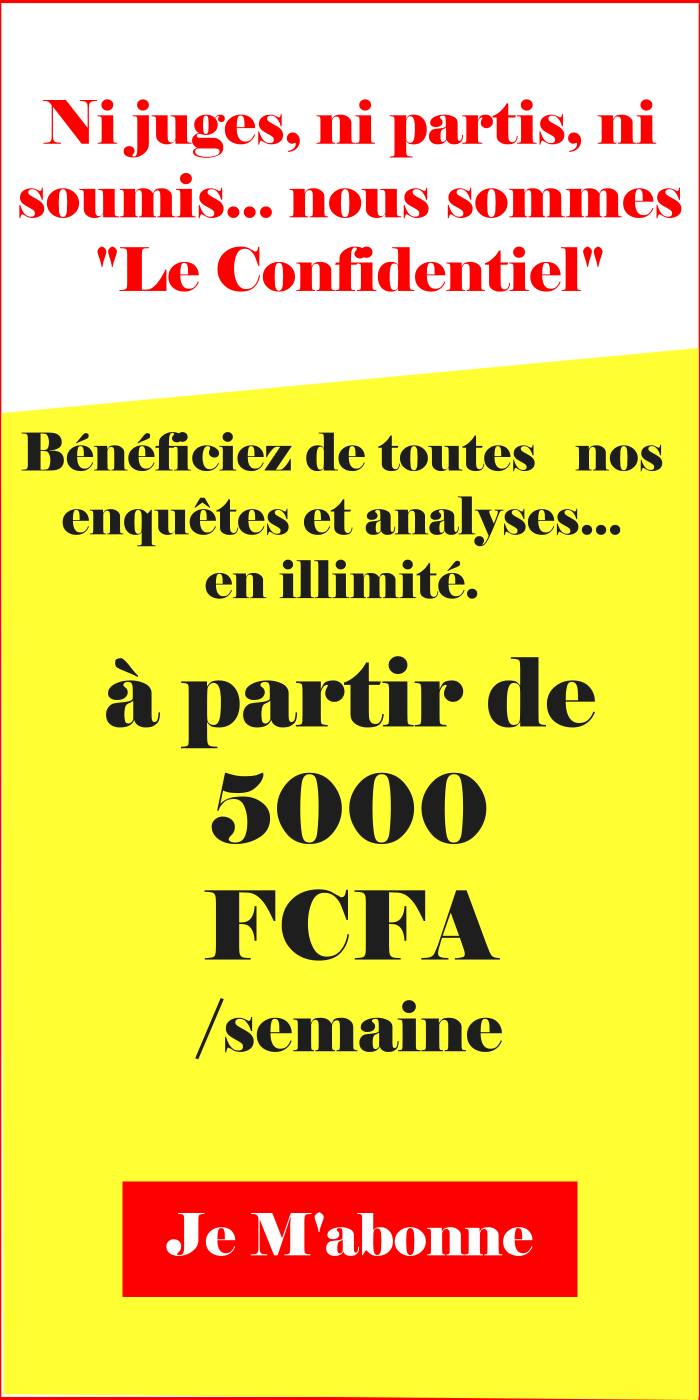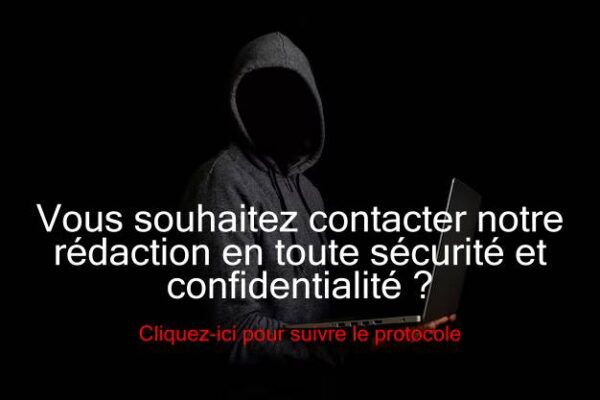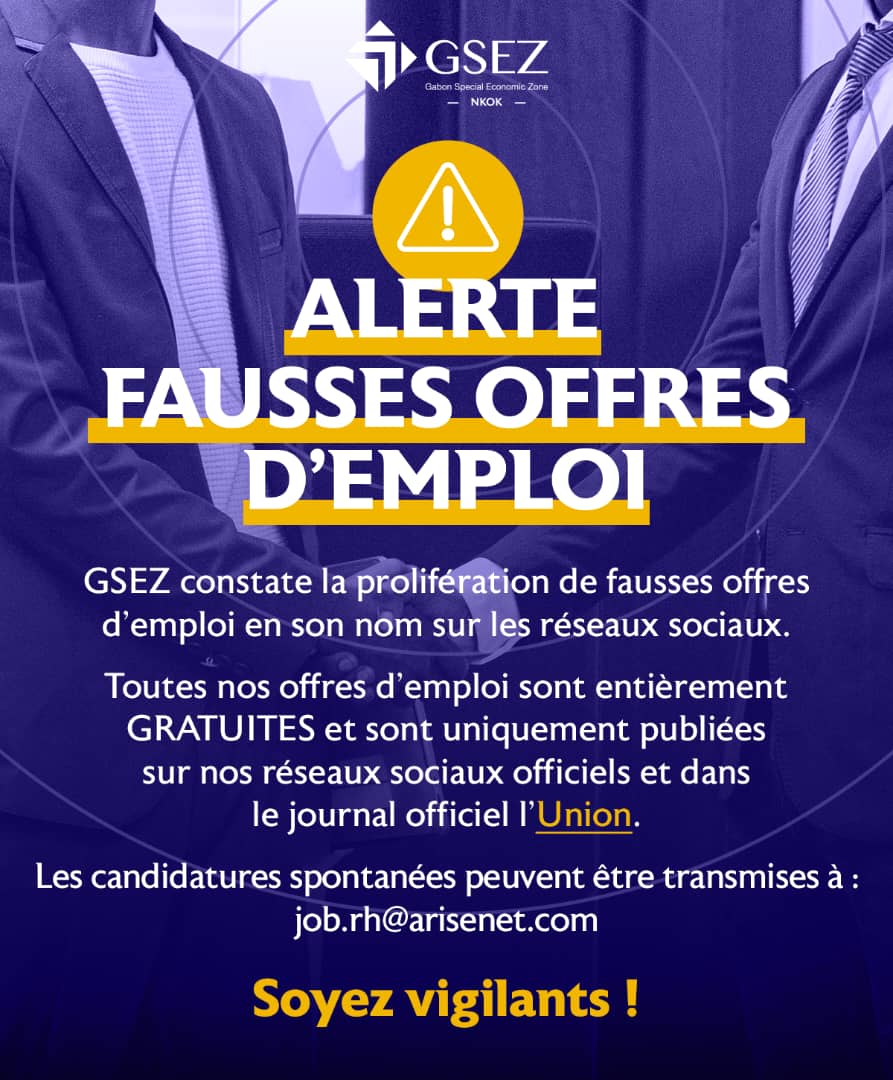La facture de l’austérité reportée sur les ménages
Les suppressions de dépenses annoncées constituent un choc direct pour les citoyens. Les mesures les plus controversées incluent l’arrêt des subventions aux médicaments et la fin de l’aide destinée à la farine et aux familles. Plus impactant encore, le soutien aux carburants est presque entièrement liquidé, passant d’un montant conséquent à seulement 12,2 milliards FCFA. Une telle réduction préfigure une flambée des prix à la pompe qui se répercutera inévitablement sur l’ensemble des biens et services, alimentant une pression inflationniste inédite.
Pour consolider ses recettes, l’État a également décidé de taxer l’électricité à 9 %, épargnant uniquement les plus démunis, et de cesser le remboursement de la TVA aux entreprises non pétrolières. Ces décisions signalent que le poids de l’assainissement budgétaire repose lourdement sur la consommation et le secteur privé, fragilisant la classe moyenne et les couches sociales vulnérables.
Le paradoxe énergétique
Cette décision d’augmenter le coût de l’électricité frappe d’autant plus les esprits qu’elle intervient en pleine crise énergétique nationale, marquée par des délestages quasi quotidiens. Le gouvernement choisit ainsi de taxer un service qui est structurellement défaillant, obligeant les ménages à payer plus cher pour une prestation jugée insatisfaisante et irrégulière. Ce paradoxe aggrave le risque de mécontentement populaire, car l’exigence d’une contribution financière accrue ne s’accompagne d’aucune garantie immédiate de stabilité ou d’amélioration de la fourniture électrique.
L’audace risquée de l’investissement massif
Le ministre Oyima justifie cette rigueur par l’urgence de réorienter les fonds vers l’investissement, tablant sur un montant historique de 3 200 milliards de FCFA, soit une augmentation de 570 %. L’exécutif fait le pari que cet afflux de capitaux dans les infrastructures générera une croissance capable d’absorber le choc social des compressions.
Toutefois, ce modèle de relance par le haut est jugé excessivement risqué. Le contexte de tension sur les marchés obligataires et l’absence d’un accord financier avec le Fonds Monétaire International (FMI) placent le Gabon dans une position délicate. En sabrant les dépenses sociales avant d’assurer la stabilité macroéconomique, les autorités prennent le risque d’une détérioration immédiate du climat social. Le spectre de la contestation plane alors que la population voit ses derniers filets de sécurité disparaître.
Dissonance entre promesses et réalités
Face aux critiques exprimées par les parlementaires quant au risque de paupérisation, le ministre d’État Henri-Claude Oyima a défendu son projet devant l’Assemblée. Il a affirmé la détermination du Gouvernement à protéger les plus vulnérables, soulignant une augmentation de 11 milliards de FCFA des dépenses sociales ciblées par rapport à 2025, portant le total à 61 milliards de FCFA.
Ces montants ciblés peinent cependant à masquer la réalité : l’augmentation des aides ciblées ne saurait compenser la hausse généralisée du coût de la vie que vont engendrer la fin des subventions au carburant et la nouvelle taxe sur l’électricité. Le budget 2026, défendu par M. Oyima, est perçu par nombre d’observateurs comme un document qui privilégie la solvabilité de l’État au détriment du pouvoir d’achat immédiat de ses citoyens.