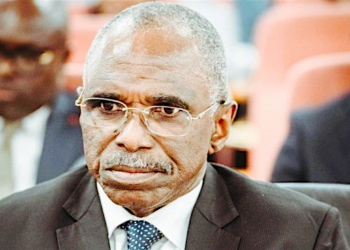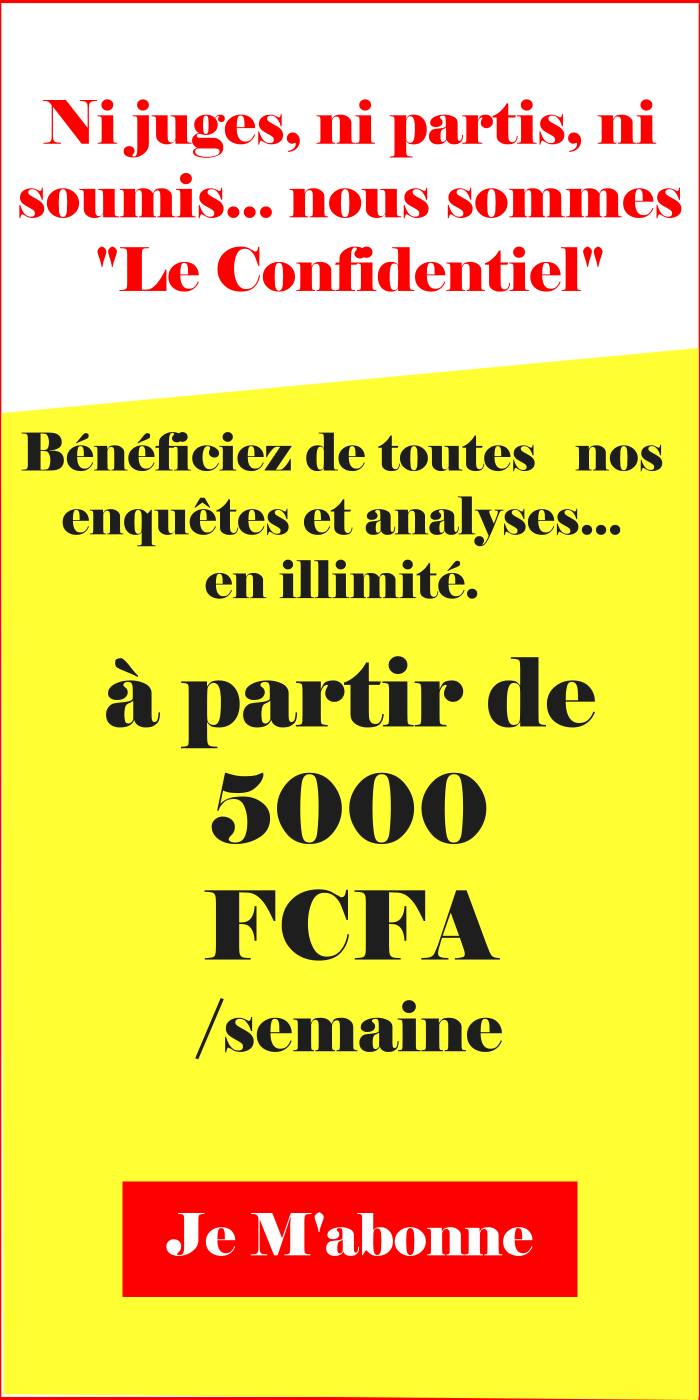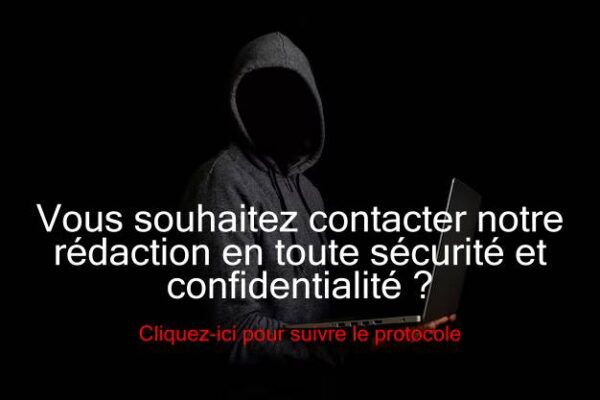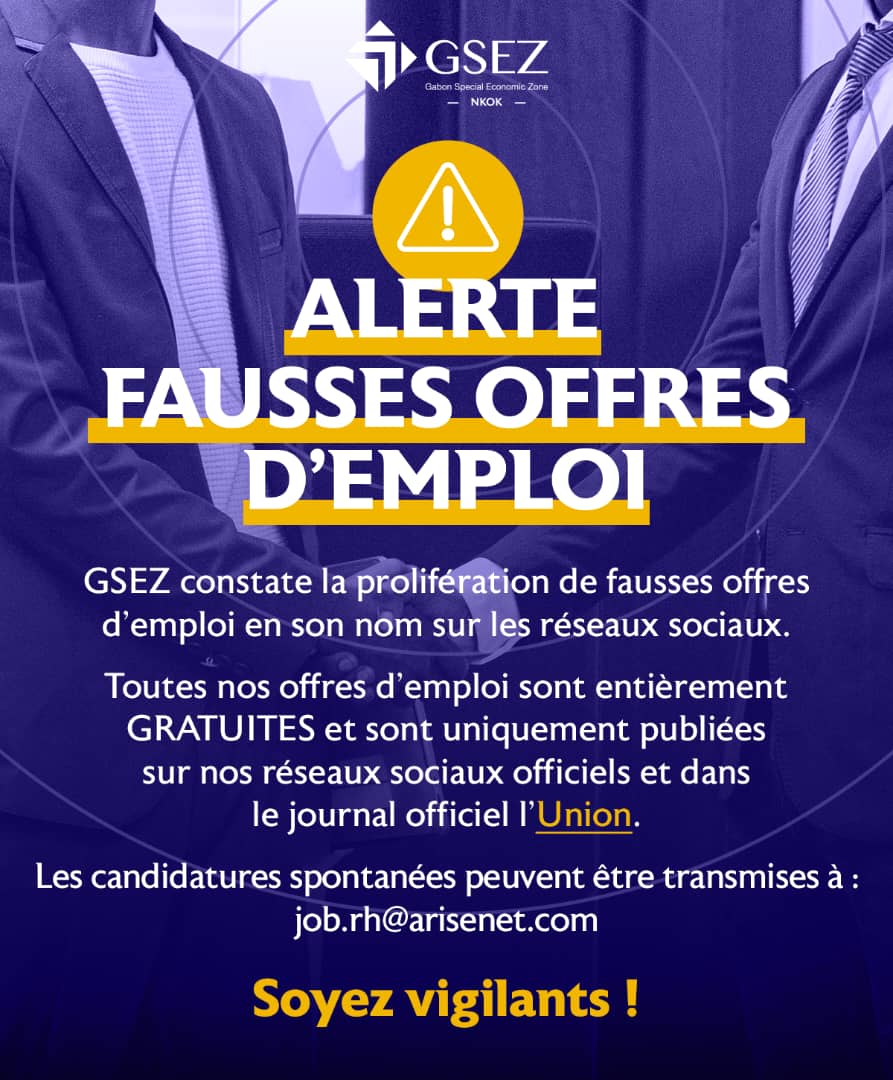Les explications de l’opérateur national, loin de rassurer, sonnent comme un aveu cinglant d’imprévoyance et de gestion hasardeuse des infrastructures. La principale raison de la crise est un “important retard” dans la mise en service d’une nouvelle centrale thermique de 150 MW. Censée être la bouée de sauvetage du réseau, cette unité est toujours “en phase de tests”, privant le Grand Libreville d’une capacité vitale. Il est inadmissible qu’un projet d’une telle importance stratégique, destiné à sécuriser l’alimentation électrique, puisse accuser un tel retard sans qu’aucun calendrier précis ne soit communiqué pour sa finalisation. Ces atermoiements témoignent d’une gestion calamiteuse des projets d’infrastructures.
À cela s’ajoute l’argument des “facteurs climatiques” : la faiblesse des précipitations dans la vallée de la Mbè, alimentant le barrage de Tchimbélé. Si la météo est un facteur naturel, l’impact qu’elle a aujourd’hui révèle la dépendance excessive et non sécurisée du réseau aux barrages hydroélectriques de Tchimbélé et Kinguélé, qui fournissent 40 % de l’électricité de la région.
La conséquence de cette fragilité structurelle est sidérante : le niveau de la retenue d’eau de Tchimbélé a atteint le seuil historiquement bas de 515,98 mètres. Ce chiffre est non seulement en dessous du “seuil critique” de 517 mètres, mais surtout plus de 15 mètres sous le “niveau normal d’exploitation” (531 mètres). Cette baisse compromet le fonctionnement même des turbines et démontre que la SEEG a laissé la situation s’aggraver jusqu’au point de rupture.
Face à son propre échec à anticiper et à livrer les infrastructures promises, la SEEG ne propose aux Gabonais qu’une solution d’urgence : le “délestage rotatif”. Ce dispositif, un euphémisme pour désigner des coupures d’électricité arbitraires, est lourd de conséquences pour l’économie et le quotidien des usagers. Le comble de l’ironie réside dans le fait que ce programme de rationnement, justifié par la nécessité de préserver le peu d’eau restant à Tchimbélé, est censé rester en vigueur… jusqu’à ce que l’opérateur parvienne enfin à mettre en service la centrale thermique tant attendue.
Cette crise énergétique n’est pas une simple péripétie. Elle est l’illustration flagrante de la vulnérabilité chronique du système électrique gabonais. Elle met brutalement en lumière le manque d’investissements structurants durables et surtout, la défaillance de la SEEG à garantir la sécurité de l’approvisionnement. Les populations du Grand Libreville ne sont pas les victimes d’un simple aléa, mais d’une impréparation chronique et de retards de livraison inacceptables qui continuent de plonger le pays dans l’obscurité. Il est temps que l’opérateur rende des comptes sur sa gestion et son incapacité à assurer une mission de service public essentielle.