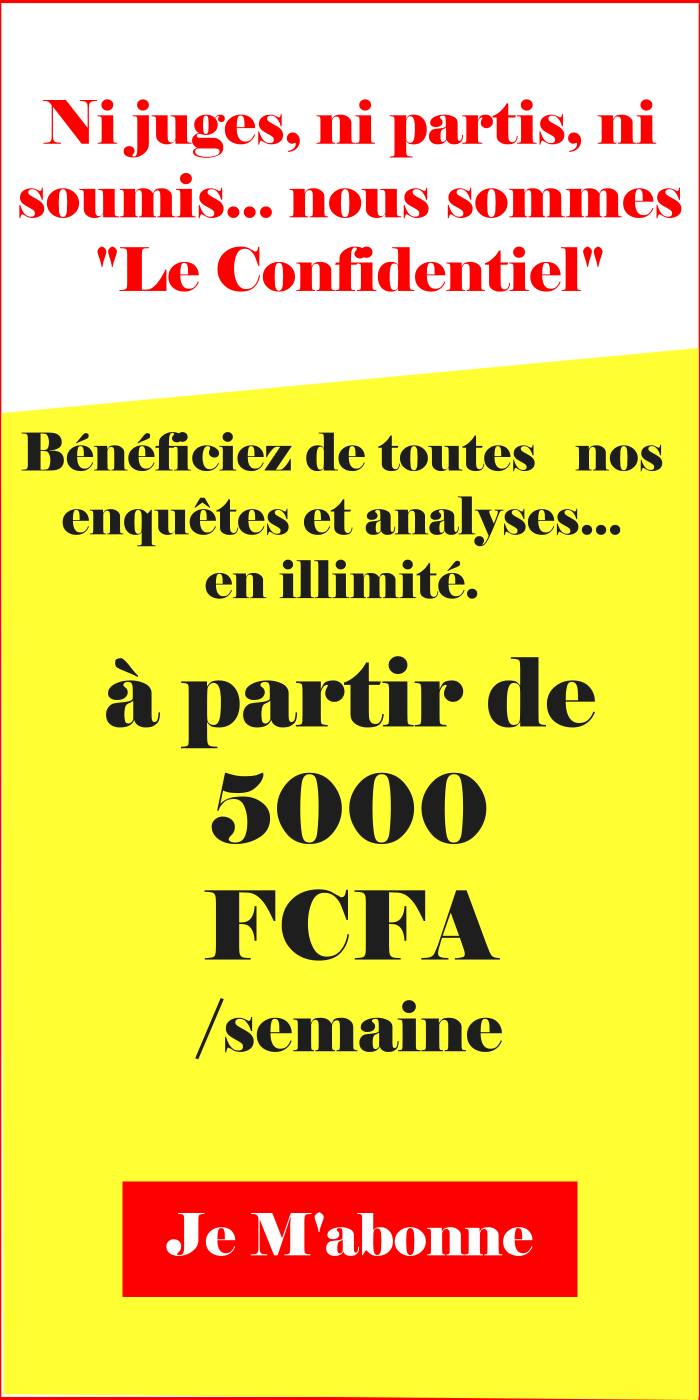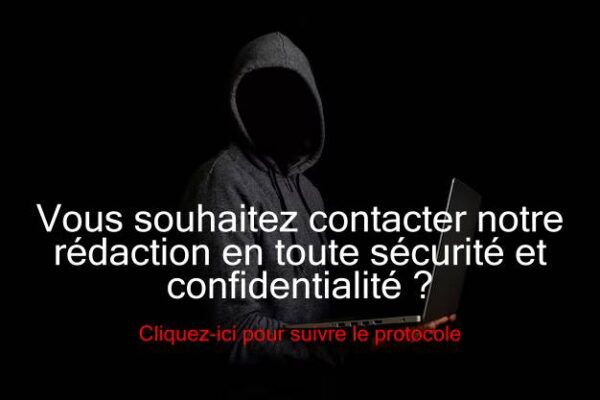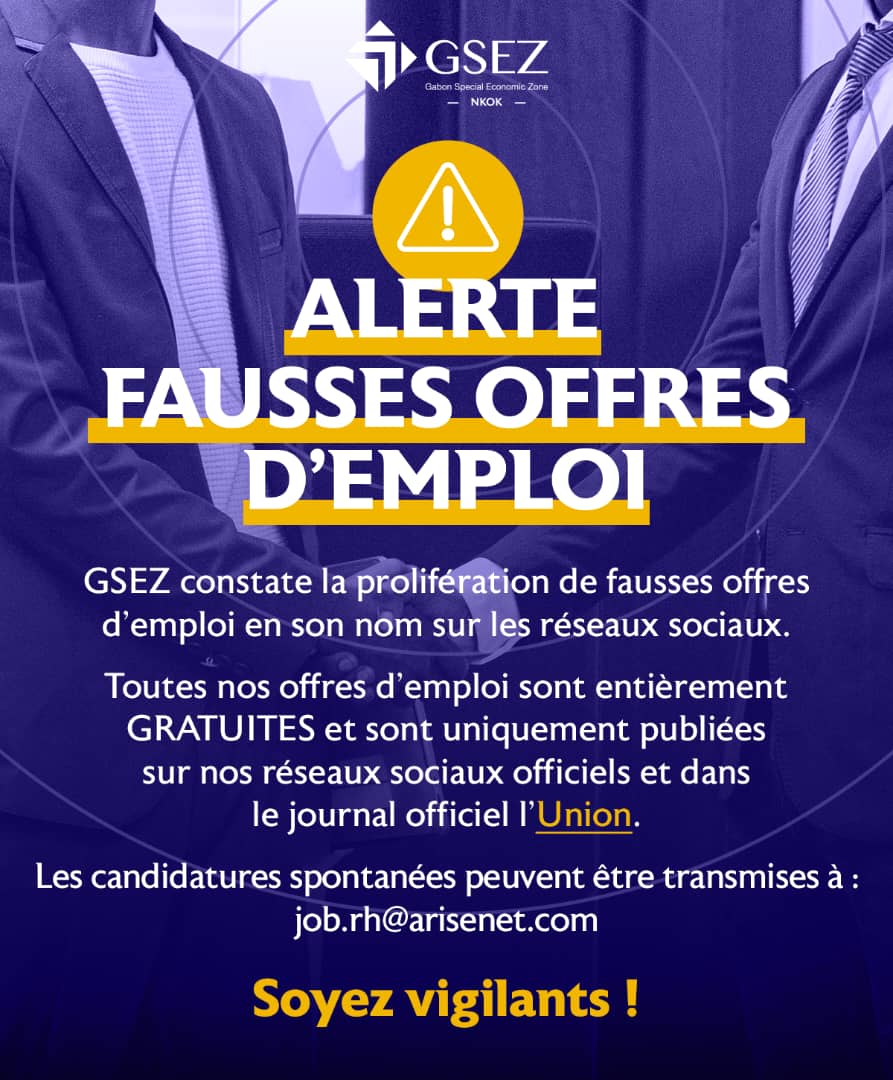Le cœur de l’affaire réside dans la mise en place d’un système financier opaque visant la captation des ressources nationales. Selon les révélations du procès, Sylvia et Noureddin Bongo auraient créé une trentaine de sociétés fictives. Ces structures, qualifiées de sociétés-écrans, auraient servi d’instruments essentiels pour le blanchiment et la dissimulation de l’origine des fonds publics détournés. L’accusation a notamment mis en évidence des preuves de transferts totalisant plus de 48 milliards de FCFA directement puisés dans le Trésor public pour être versés sur les comptes privés des entreprises de Noureddin Bongo-Valentin.
Ce dernier est également poursuivi, avec d’autres coaccusés, pour la perception de bonus pétroliers injustifiés.
Des actes présumés d’atteinte à l’exercice du pouvoir viennent compléter le tableau des accusations. Sylvia Bongo est poursuivie pour faux et usage de faux après qu’un témoin, Park, a affirmé avoir vu l’ex-Première dame parapher des documents officiels en utilisant le cachet présidentiel. Ces actes suggèrent une usurpation de signature et un exercice illégal de l’autorité au plus haut niveau de l’État.
Enfin, les enquêtes ont révélé l’étendue de l’enrichissement illicite du clan. Il a été exposé que Sylvia Bongo détenait plus de 25 Sociétés Civiles Immobilières (SCI), gérant un patrimoine foncier considérable représentant 33 titres fonciers. L’enrichissement s’étendrait au bénéfice de son fils mineur, Jalil Bongo. Des sociétés créées en son nom, comme Capella et Equarius, bien que sans activité économique réelle, auraient généré plus d’un milliard de FCFA de dividendes par an grâce à des participations dans la BGFIBank. De plus, la fondation Ruban Vert est soupçonnée d’avoir servi au blanchiment, son capital ayant augmenté de 500 millions à 8 milliards de FCFA sans justification probante.
Exilés à Londres depuis mai dernier, Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddin Bongo Valentin sont jugés par contumace.