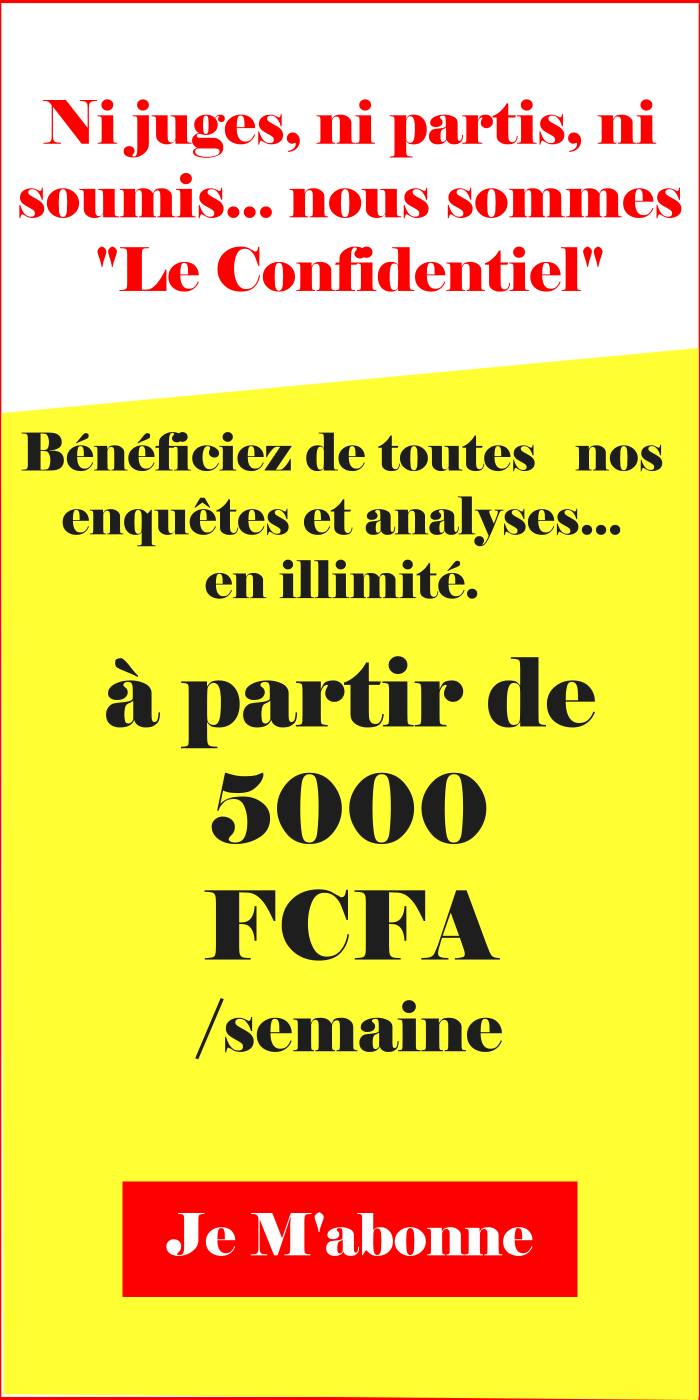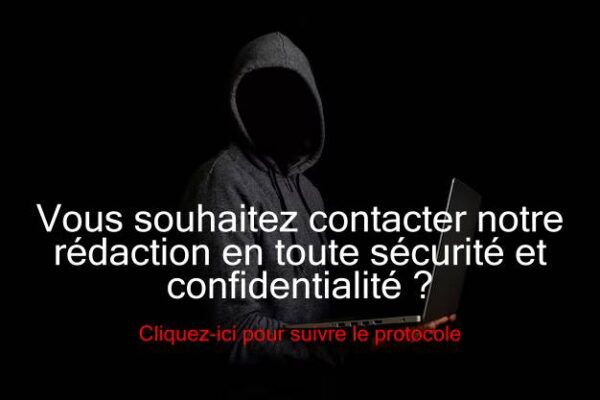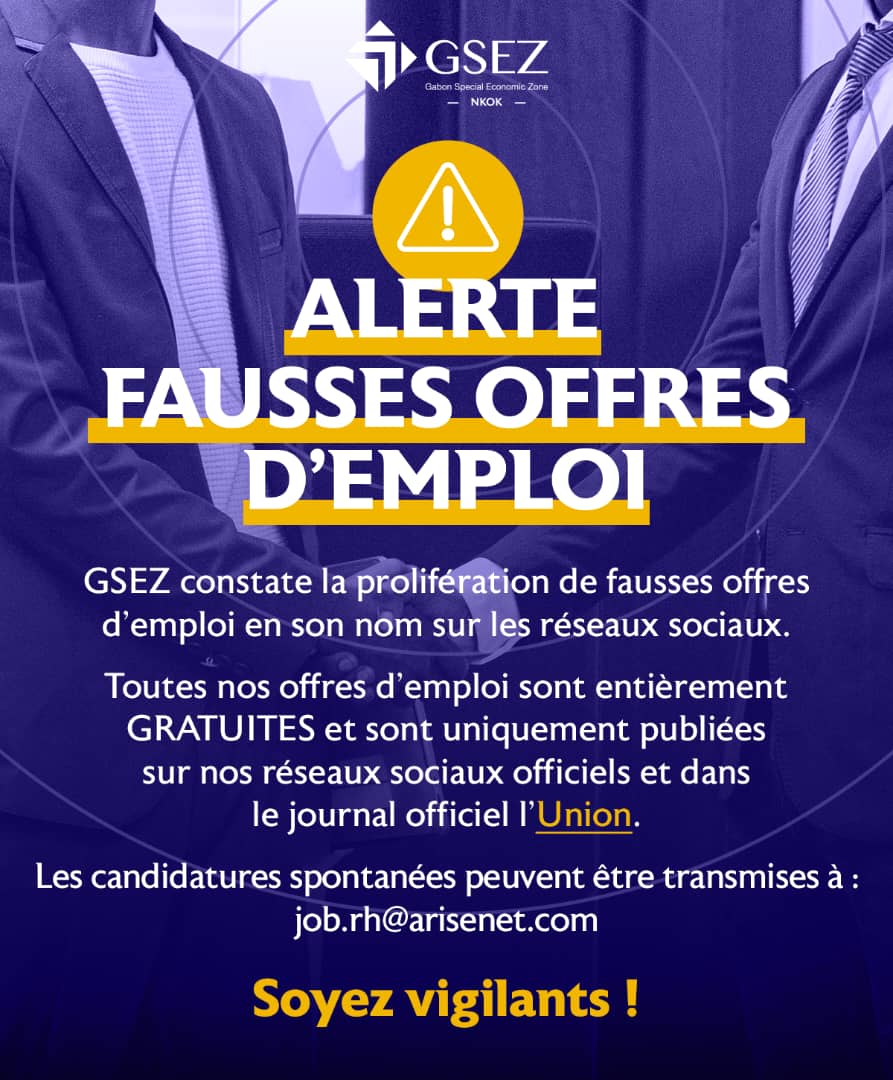Clarifications sur la procédure et les arguments du Gabon
Interrogé sur la pertinence de la Convention de Bata de 1974, prétendument “rejetée” par la CIJ et qualifiée d’argument central de la défense gabonaise, Rossatanga-Rignault a catégoriquement démenti. “Le Gabon n’a pas plaidé pendant des années en s’appuyant sur la Convention de Bata de 1974. Cette affaire n’a été plaidée devant la CIJ qu’en décembre dernier”, a-t-il précisé, fustigeant la prolifération d’informations erronées. Il a également souligné que la défense gabonaise reposait sur des milliers de pages de documents, et non sur un unique “argument central”.
Concernant la notion de “pari risqué”, l’Agent du Gabon a rappelé qu’en justice, l’issue d’un procès est toujours incertaine. “Lorsqu’on va devant un tribunal, même pour un divorce ou un vol, on ne sait jamais ce que les juges vont décider. Ça s’appelle la justice.” Il a également insisté sur le fait que le Gabon était en position de défendeur, la Guinée Équatoriale ayant rejeté toute solution diplomatique pendant 20 ans avant de saisir la CIJ.
La prééminence du droit des traités coloniaux
Quant à la décision de la CIJ de s’en tenir aux textes coloniaux de 1900, notamment la Convention franco-espagnole de 1900, Rossatanga-Rignault a tenu à rectifier une perception répandue. “Ce que vous appelez les textes coloniaux de 1900 sont… justement des traités.” Il a expliqué que c’est en vertu de cette convention que la frontière terrestre sera désormais fixée selon des lignes droites (parallèles et méridiens), entraînant le retour au Gabon de territoires situés à l’Est du méridien concerné.
En revanche, la souveraineté de la Guinée Équatoriale sur les îles n’a pas été affirmée en vertu d’un traité colonial. La Cour a estimé que l’Espagne y avait exercé sa souveraineté pendant la période coloniale, “aucun traité colonial ne le dit”, a-t-il souligné, invitant une fois de plus à la lecture de l’arrêt complet de la CIJ.
Droit et géopolitique : une fausse dichotomie ?
Face aux critiques dénonçant une stratégie “trop académique” déconnectée des réalités géopolitiques, Rossatanga-Rignault a rétorqué avec fermeté. “Que voulez-vous que je réponde à des gens qui s’insurgent contre l’usage du droit devant une Cour où on est censé faire… du droit ?” Il a mis en exergue l’absence de clarté quant à ce que recouvrent les termes de “carte diplomatique” ou “stratégique” dans le cadre d’un procès.
Concernant les conséquences du verdict, et la phrase “le Gabon et la Guinée équatoriale sont condamnés à vivre ensemble”, il a rappelé que “le droit et l’émotion ne font pas bon ménage”. Il a insisté sur l’évidence géographique de cette cohabitation et a souligné la position claire du Gabon : “une décision a été rendue. Les deux parties doivent s’asseoir, seules ou assistées, pour la faire appliquer dans sa totalité : le tracé de la frontière terrestre, la souveraineté sur les îles et la négociation de la frontière maritime qui n’existe pas aux yeux de la Cour.”
Le principe de l’Uti Possidetis Juris et les gains territoriaux
Rossatanga-Rignault a réfuté l’idée que ce jugement ouvre une “brèche dangereuse” pour d’autres différends frontaliers africains. Il a rappelé que la CIJ tranche depuis toujours les différends territoriaux en Afrique et ailleurs selon le principe de l’Uti Possidetis Juris (respect des frontières héritées de la colonisation), un principe fondamental du droit international public et de l’Union Africaine. “Ne pas le savoir expose à toutes les élucubrations qu’on lit ici et là”, a-t-il asséné.
Enfin, concernant les gains territoriaux pour le Gabon sur la partie continentale, notamment autour d’Ebebiyin et de Mongomo, l’Agent du Gabon a confirmé. “Dès lors que le seul titre reconnu par la CIJ en matière de frontière terrestre est la Convention de 1900, la frontière terrestre entre les deux États doit être fixée conformément à cette Convention de 1900.” Il a expliqué que la rivière Kyé comme frontière est le produit de la Convention de Bata de 1974, non reconnue par la CIJ sur ce point. Cela implique la rétrocession au Gabon de tous les territoires concernés, soit environ 300 km².